Le cauchemar de Tocqueville
Si toi aussi tu te sens de plus en plus oppressé.e par la simple vue d'un formulaire, c'est que ton radar à oppression commence à s'affoler & à se demander si nous ne vivons pas un enfer démocratique.
“Il faut relire Tocqueville”.
J’ai dû prononcer cette phrase un nombre incalculable de fois.
Toutes les fois où la conversation tourne autour de cette sensation de limitation, de contrainte, d’anxiété sourde qui monte à mesure que nos pas sont plus et mieux régulés, que les petits et grands interdits se multiplient, qu’il faut toujours et encore plus marcher dans les clous, montrer patte blanche, filer droit, n’avoir rien à cacher, cotiser sur des cotisations, j’en passe des injonctions, et des meilleures.
Le brave Tocqueville, célèbre pour sa Démocratie en Amérique, publiée en 1835 (Tome 1) et 1840 (Tome 2), fut philosophe, sociologue avant l’heure, et aussi homme politique. C’est mon love love intellectuel. Presque plus que La Boétie, c'est vous dire.
Pourquoi tant d'amour ? C'est qu'il a tellement bien décortiqué et analysé les ressorts des sociétés démocratiques, alors à peine naissantes, qu’il a su voir, et craindre, les pires dérives dont est capable un régime démocratique. Madame Irma n’a qu’à bien se tenir, car il y a du level.

Pour Tocqueville, la démocratie n’est ni bonne, ni mauvaise en soi, elle n’est qu’un instrument aux mains des individus, à qui il appartient de faire en sorte qu’elle réalise sa promesse : une société d’individus égaux avant tout, libres surtout, responsables de la chose publique dont ils aiment s’occuper autant que de leurs affaires personnelles.
Ça c'est l'idéal. Mais dans les faits, la démocratie peut virer au grand n'importe quoi et prendre les traits d'une autocratie en toute décontraction.
Ceci explique pourquoi des régimes autoritaires pour ne pas dire totalitaires peuvent se dire démocratiques. Pour vous en convaincre, jetez juste un œil au générique du très bon documentaire sur la question, Démocratie(s). Il offre une belle brochette de “démocrates”.
Ce n’est pas de la provocation, c’est juste que la démocratie peut engendrer la meilleure des sociétés comme la plus moisie. On ne répétera jamais assez que Hitler a été élu démocratiquement.
Mais sans aller jusqu’à porter des dictateurs au pouvoir, la démocratie peut tout simplement accoucher d’un monstre moins intuitif mais tout aussi flippant, le “despotisme mou”.

C'est quoi un despotisme mou ?
On pensait que le despotisme c’était nécessairement la schlag. Et bien non, il y a la version soft, un truc qui ne ressemble pas ouvertement à un régime dictatorial mais qui n’aurait rien à lui envier. Un machin qui régule, oppresse, contraint, domine, gratifie et punit au nom du peuple, au nom du bien commun, au nom de l’égalité, de la solidarité, de la justice, de la sécurité, de la santé, du réchauffement climatique et même de la liberté. On ne se refuse rien.
Tocqueville le nomme “pouvoir tutélaire” ou “souverain” ou encore “gouvernement”. De nos jours, il répond au dur nom “d'État”.
Donc c’est nous, puisque l’État c’est nous, n’est-ce pas?
Un peu comme Baudelaire affirme que “la plus belle des ruses du Diable est de vous persuader qu'il n'existe pas”, j’ai envie de dire que “la plus belle des ruses de l’État est de nous persuader qu’il est nous”.
Car on confond un peu tout, ou du moins on glisse facilement de peuple à nation et de nation à État et vice-versa. Tout ça c’est le même gloubiboulga, n'est-ce pas ?
C’est qui le peuple ? C’est nous.
La nation ? Encore nous.
C’est qui qui vote quand on lui dit qu’il le faut ? C’est nous.
Qui vote pour qui ? Des représentants du peuple.
Ça forme quoi tout ça ? L’État.
C’est qui l’État ? C’est nous.
Mouais. Pas si vite papillon.

Larousse nous dit que l’État, avec un E majuscule, désigne une forme de “société politique résultant de la fixation, sur un territoire délimité par des frontières, d'un groupe humain présentant des caractères plus ou moins marqués d'homogénéité culturelle et régi par un pouvoir institutionnalisé”.
En droit constitutionnel, l'État est une personne morale territoriale de droit public personnifiant juridiquement la nation, titulaire de la souveraineté interne et internationale et du monopole de la contrainte organisée”.
Il précise qu’une seconde définition est possible, et vise les “éléments centraux de l'Administration, l’ensemble des pouvoirs publics, par opposition aux citoyens”.
2 choses me sautent aux yeux et me chagrinent dans ces 2 définitions plutôt complémentaires.
1ère fracture de l’œil droit : l’État, en tant que personne morale blabla est titulaire, entre autre, du “monopole de la contrainte organisée”. Rien que ça. Je ne sais pas ce que c’est que la contrainte organisée, mais il y a un petit côté “violence en bande organisée” ou “fraude en bande organisée” qui m’inspire moyennement.
2ème fracture de l’œil gauche cette fois, pour ne pas faire de jaloux : “par opposition aux citoyens”. Comme les couleurs qui s’opposent d’après l’exemple donné par le Larousse. Déjà si ça s’oppose à nous, gens du peuple “citoyens”, c’est que ce n’est pas nous.
Certes. Mais Larousse nous dit quand même que l’État “personnifie juridiquement la nation”.
La nation, on a le droit quand même ? c’est nous, non ?

Peut-être que oui, puisqu’elle peut se définir comme “ensemble des êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de traditions, parfois de langue, et constituant une communauté politique”. Encore faudrait-il s’entendre sur la notion de “communauté politique”, mais je n'ai pas le courage de creuser davantage.
Larousse nous dit que la nation peut aussi se définir comme “entité abstraite, collective et indivisible, distincte des individus qui la composent et titulaire de la souveraineté”. Et là, mes amis, ça ressemble bien au truc dont l’État est la personnification juridique.
Ce qui me chiffonne, c’est que c’est une “entité distincte des individus qui la composent”. Donc si c’est distinct de nous, ce n’est pas nous, on est d’accord ? Mais on la compose quand même…cette entité abstraite, qui par définition s’oppose au concret, donc à nous, pauvres êtres faits de chair et de sang ?
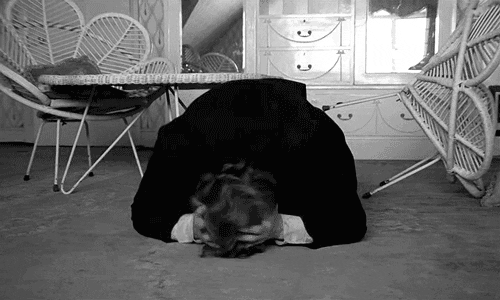
Je me demande si l’État français a défini officiellement ce qu’est l’État justement. Ben pardi que oui. Enfin, il nous propose un article à lire en 8 minutes, dont le chapô annonce la couleur : “L’État est à la fois une réalité historique et une construction théorique, ce qui explique la difficulté de le définir de manière pleinement satisfaisante”. Il est sérieux Franck Baron, Conseiller de l’Assemblée nationale, quand il écrit ça ? On vit sous un régime dit d’État, mais l’État lui-même ne sait pas trop comment se définir “de manière pleinement satisfaisante”… tu m’étonnes que tout fout le camp, ma brave dame.
Mauvais esprit à part, l’ami Baron confirme la définition du Larousse mais il va plus loin aussi en rappelant son rôle d’État-Providence dans les sociétés contemporaines, où “l’action de l’État ne se limite plus aux seules fonctions liées à l’exercice de la souveraineté. Son champ d’intervention s’est étendu à de nombreux domaines où existe un intérêt général qui ne peut être satisfait par la seule action des particuliers (ex : éducation, santé, culture, recherche...). (…) Il est également devenu un élément de cohésion sociale et un garant de l’égalité entre les individus qui le composent”.
Ahhhhh l’égalité, nous y voilà.

On va pouvoir rappeler copain Tocqueville pour comprendre pourquoi on se sent de plus en plus à l’étroit dans nos habits de citoyens de la chose publique française.
Tocqueville nous explique que la démocratie, avant d’être un régime politique, est un état social. Il est bottom up notre Tocqueville et considère que tout changement profond part de la base pour finir par nécessairement se traduire en institutions politiques. S’agissant de la démocratie, elle se caractérise selon lui par une “égalité des conditions” des individus vivant sous ce régime. Une égalité en droit et en dignité cela va de soi et nous est d'ailleurs rappelé dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen.
L’affaire est à la fois très simple et très compliquée, dès lors qu’il s’agit de transposer ce principe d’égalité des conditions au terrain politique, car pour être cohérent, “il faut donner des droits à chaque citoyen, ou n’en donner à personne”.
Si nous sommes tous égaux par principe, il faut que tous règnent (tous égaux dans le pouvoir) ou qu’un seul règne (tous égaux dans la servitude). Et c’est là que les choses se gâtent comme dirait ma tante Agathe (j’ai pas de tante Agathe, mais ça sonnait bien 🤭).
Nous, on veut pas de tyran !

Non mais. On a pas dézingué toute une famille royale pour rien.
Mais il n’est pas question que ça dépasse entre hommes et femmes égaux, et on a mieux à faire que de s’occuper des affaires publiques. Il faut donc bien que la puissance de la force collective soit cristallisée en une “entité abstraite, collective et indivisible, distincte des individus qui la composent et titulaire de la souveraineté” (la nation), personnifiée juridiquement par l’État, dont le bras armé, pardon, le bras actif, est l’administration.

Voilà la promesse du pouvoir étatique, à même de garantir une égalité sur le papier, pour ne pas dire en carton pâte, à l’ensemble des citoyens qui deviennent, ô mot pas cool, des “administrés”. Littéralement des “personnes qui dépendent d'une administration, d'une autorité administrative”.
Et c’est peu dire que nos vies aujourd’hui dépendent, à un niveau jamais atteint, des administrations : fais pas ci, fais donc ça, gare toi là, bouge de là, paye ceci, rembourse cela, pense ceci, ne dit pas ça.
Précisons que pendant que l’État et ses organes opèrent et gèrent, en lieu et place des individus qu’ils sont censés servir et représenter, les individus s’en foutent plein la tête de conneries décérébrées, d’opinions toutes plus incantatoires les unes que les autres, de quête et d’accumulation de biens et goodies en tout genre, de leurs p'tites affaires, avec leurs p'tits chapeaux, avec leurs p'tits manteaux, avec leurs p'tites autos (#BrelForEver❤).
Et ils appellent ça liberté.

A bien y regarder, Tocqueville est sans doute le premier observateur critique des dérives potentielles du matérialisme et de l’individualisme qui menacent toute société démocratique dont les membres auraient mal interprété la liberté justement.
Elle est certes un principe et un droit à l’autonomie et à l’autodétermination, “un droit égal et imprescriptible à vivre indépendant de ses semblables, en tout ce qui n’a rapport qu’à (soi)-même, et à régler comme (on) l’entend sa propre destinée” (#jefaiscequejeveuxavecmescheveux).
Mais elle est aussi un devoir et une responsabilité civique, qui devrait s’accomplir dans la participation aux affaires publiques, autrement dit dans l’action politique, qui ne se résume pas à se déplacer bon gré, mal gré, en se traînant tous les 5 ou 6 ans pour voter pour les professionnels de la chose politique, qui feront le taf à notre place, sans garantie que ce soit vraiment toujours au meilleur service de nos intérêts.
Car voilà, politique c’est devenu un taf, qui paye plutôt bien, plutôt gratifiant socialement, mais qui coûte cher en salamalecs et petits et grands jeux de pouvoir, et pour lequel mieux vaut avoir quelques entrées. Très peu pour beaucoup de gens. Dont moi, il faut bien le dire.

Soyons francs, la démocratie a totalement dérapé en France, et on doit bien lui faire de la peine au père Tocqueville s’il nous observe du ciel, des limbes, ou de nowhere, lui qui avait tout vu venir. Morceaux choisis pour s’en rappeler :
“Le naturel du pouvoir absolu, dans les siècles démocratiques, n'est ni cruel ni sauvage, mais il est minutieux et tracassier. (…)
L’habitant (des contrées démocratiques) se considère comme une espèce de colon indifférent à la destinée du lieu qu'il habite. Les plus grands changements surviennent dans son pays sans son concours; il ne sait même pas précisément ce qui s'est passé ; il s'en doute ; il a entendu raconter l'événement par hasard. Bien plus, la fortune de son village, la police de sa rue, le sort de son église et de son presbytère ne le touchent point ; il pense que toutes ces choses ne le regardent en aucune façon, et qu'elles appartiennent à un étranger puissant qu'on appelle le gouvernement. (…)
Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière; il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige; il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse; il ne détruit point, il empêche de naître; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation a n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger.
J'ai toujours cru que cette sorte de servitude, réglée, douce et paisible, dont je viens de faire le tableau, pourrait se combiner mieux qu'on ne l'imagine avec quelques unes des formes extérieures de la liberté, et qu'il ne lui serait pas impossible de s'établir à l'ombre même de la souveraineté du peuple”.
La meilleure façon de se convaincre qu’on est en plein cauchemar tocquevillien, c’est de penser à la dernière fois où on a eu à faire une démarche administrative.

Kafka en enfer, bonjour.
Je n’ai pas réussi à trouver de chiffres pour les particuliers, mais pour les TPE/PME, l’étude “À la recherche du temps perdu : impact du poids de la bureaucratie”, publiée en 2017 par Sage et Plum Consulting, révèle qu’en moyenne 142 jours de travail par an sont consacrés à la gestion administrative, soit une perte de productivité d’environ 43 milliards d’euros. Ça en fait du temps et du pognon, à courber l’échine pour satisfaire aux obligations de ci et de là, puisque près de 60% du temps consacré à l’administratif est occupé par des tâches avant tout imposées par la loi (Comptabilité, RH / Paie hors Recrutement et Fiscalité).
La meilleure, c’est qu’on a tendance à taxer de soviétique ce genre d’emprise hypra-oppressante. Mais on se trompe les amis. Le regretté anthropologue anarchiste David Graeber dénonçait dès 2015 la “Bureaucratie”, dans un gros pavé éponyme, qui part un peu dans tous les sens, mais qui a le mérite de poser un constat inattendu : la bureaucratie vorace que nous subissons chaque jour un peu plus est aussi bien la fille des organes publics, que l’infâme rejeton de l'économie néolibérale.
Oui, vous avez bien lu. Néolibérale.

Dans une économie mondialisée et financiarisée jusqu’au dernier cents, services publics et sociétés privées produisent encore et toujours plus de paperasse, souvent de concert, à la seule fin de toujours mieux et encore plus nous dominer et in fine nous exploiter.
La tyrannie bureaucratique. Vaste sujet. Pour lequel il faut aussi se référer à l’excellent ouvrage Le Labyrinthe de Jacques Bichot, dont le sous-titre sonne comme un programme politique : “Compliquer pour régner”.
Ce n’est pas Graeber qui le contredirait car pour lui la bureaucratie exerce une réelle violence, à des fins politiques. Elle est au service avant tout d’enjeux de contrôle social et de discipline au travail, enjeux qui passent avant la productivité, la croissance et la rentabilité.
Curieux pour une doctrine néolibérale ?
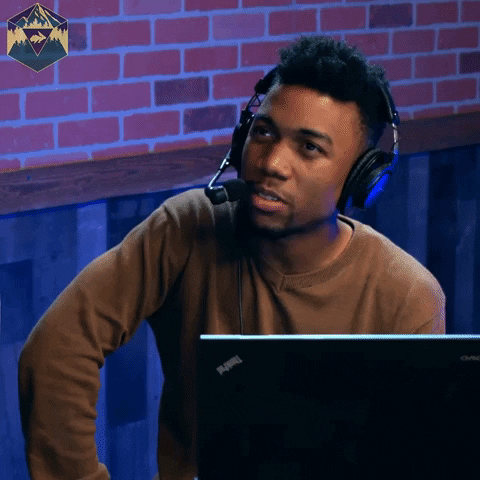
C’est un investissement.
D’abord on domestique, ensuite on exploite, enfin on rentabilise.
Ça a toujours bien fonctionné avec les animaux, pourquoi pas avec les humains ?
Et qui dit que ça ne fonctionne pas déjà très bien ?




